Introduction générale
Objectif de la leçon
Au-delà de l’oral du bac il s’agit de faire de la philo et de travailler autrement le programme
Notions traversées par le texte de Foucault : L’État, La justice, La liberté, La technique, Le temps, Le travail, La vérité.
Présentation de l'ouvrage
Surveiller et punir, est un texte publié en 1975 par Michel Foucault dans lequel il s'efforce de rendre compte de la manière dont le pouvoir s'est exercé sur les individus, il vise notamment à faire la généalogie de la prison qui relève d'un mode d'exercice du pouvoir historiquement daté.
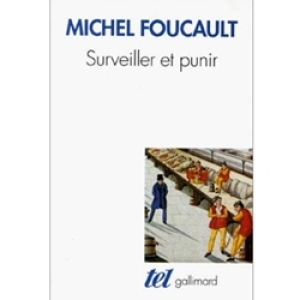
En 1975 « Michel Foucault est un intellectuel reconnu, qui jouit d'une position éminente à la fois dans le monde académique – il a été nommé professeur au Collège de France en 1970 – et médiatique, où son avis est régulièrement sollicité par la presse nationale. Depuis le début des années 1970, son engagement politique s'est accru, et Foucault entreprend dès 1972 de théoriser la position qu'il entend adopter à l'intersection du monde militant, du champ académique et de la sphère publique ; ce travail aboutit en 1976 à la formalisation du concept d'intellectuel spécifique »
(Wikipédia)
L'auteur à travers ce texte s'efforce donc d'avoir un impact politique, il ne s'agit pas seulement de rendre compte d'une réalité historique mais de produire des changements dans la société de son temps.
« Par cette réflexion généalogique, Foucault cherche – comme à son habitude – à mettre en crise les pratiques en questionnant les processus qui sous-tendent la constitution et la stabilisation de certains phénomènes dans le temps. »
(Revue du MAUSS)
Récit historique ou manifeste politique
Si l'on s'en tient à la lettre du texte de Foucault on peut en conclure que nous avons affaire à une description historiquement datée. De fait il y propose une analyse qui se situe entre le Moyen Âge et le XVIIIe siècle.
À moins d'être historien une telle étude peut sembler laborieuse voire franchement dépassée.
« Foucault ne faisait pas de la reconstitution du passé une fin en soi, ni même un moyen d’expliquer des faits singuliers à partir du contexte historique dans lequel ils sont apparus. Il instrumentalisait l’histoire pour problématiser le temps présent. »
(M.-C. Granjon)
Par les différences entre le passé et le présent, il s'agit de faire surgir un sens.
Sans le détour historique le présent nous semble normal, en le confrontant au passé on parvient à le mettre en perspective et à faire surgir du sens.
C'est ainsi qu'il convient de comprendre le texte de Foucault, non comme un témoignage du passé mais comme une clé de lecture du présent, un moyen de donner sens à notre actualité et de modifier cette réalité.
Impossible d'accéder à la ressource audio ou vidéo à l'adresse :
La ressource n'est plus disponible ou vous n'êtes pas autorisé à y accéder. Veuillez vérifier votre accès puis recharger la vidéo.
Transcription textuelle
La complexité du réel
Nous sommes confrontés ici à un discours situé, c’est-à-dire qu’il ne cherche pas à peindre objectivement le réel tel qu’il se donne dans toute sa complexité, mais au contraire de le saisir selon une perspective singulière.
Par conséquent il oblitère volontairement un grand nombre d’éléments pour rendre visible une ligne de sens qui sans cela resterait trop diffuse pour être saisie.
Ce n’est pas le propre de Foucault ou de la philosophie de fonctionner de cette manière. Tout discours un tant soit peu radical sur la réalité est nécessairement situé.
Lorsque nous critiquons une personne ou une institution (plus encore lorsque nous nous mettons en colère) nous ne nous y prenons pas différemment.
Nous appuyons de manière caricaturale sur des aspects qui nous posent problème et nous oublions pour un temps les aspects positifs. Si notre discours n'est pas honnête il permet de prendre conscience d'un élément qui jusqu'alors était susceptible d'échapper à notre attention.
Ainsi quand Bertolt Brecht écrit : « On dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent. Mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qui l'enserrent. »
il tente de faire dévier notre regard, de le tourner vers un élément singulier qui sans lui nous échappe.
Il convient d’être partial pour faire surgir à la conscience des réalités qui sans cela resteraient confuses.
Si l'on s'en tient à une lecture au premier degré du texte de Foucault on y voit une critique indépassable de la réalité, on est amené à sombrer dans le complotisme, comme si une élite planifiait consciencieusement l'annihilation de la grande majorité des individus. Ce n'est bien entendu pas le cas. La réalité déborde de beaucoup la peinture qu'en propose Foucault.
De fait, je ne crois pas que l’être humain soit mauvais en lui-même, je dirais avec Socrate que nul n’est méchant volontairement. La méchanceté pour Platon est davantage le résultat d’une ignorance que d’une volonté concertée.
Le monde est d’une telle complexité, chaque situation fait résonner tant de lignes qui s’enchevêtrent qu'il est difficile de s'y retrouver. D'autant que c’est à nous de donner sens, c’est-à-dire de saisir tel ou tel aspect au détriment des autres.
Ainsi quand Russell dans Essais sceptiques dit que les bourgeois londoniens préfèrent conserver leur repas fastueux plutôt que venir en aide aux miséreux, c’est une manière de rendre compte de la situation qui n’est sans doute pas partagée par ces bourgeois eux-mêmes, ceux-ci font résonner d’autres éléments du réel qui sont également rationnellement acceptables.
Être méchant consiste la plupart du temps à ne pas voir certains éléments du réel, à porter son attention sur d’autres éléments qui eux cadrent davantage avec notre désir.
C’est ici que le travail de Foucault prend tout son sens, il met le doigt sur des éléments que nous pouvons laisser dans l’ombre ou en périphérie, il nous oblige à prendre conscience d’une part de la réalité qui sans lui resterait essentiellement inaperçue.
Sur cette question je conseille la lecture de La trahison des clercs de Julien Benda (1927).
Cet élément, sur lequel je reviendrai, doit être gardé à l'esprit durant l'ensemble de la leçon.
Le Pharmakon
Je souhaite également faire état d'un concept de Bernard Stiegler (1952-2020) qui va un peu dans le même sens : le Pharmakon.
« En Grèce ancienne, le terme de pharmakon désigne à la fois le remède, le poison, et le bouc-émissaire. Tout objet technique est pharmacologique : il est à la fois poison et remède. Le pharmakon est à la fois ce qui permet de prendre soin et ce dont il faut prendre soin, au sens où il faut y faire attention : c’est une puissance curative dans la mesure et la démesure où c’est une puissance destructrice. Cet à la fois est ce qui caractérise la pharmacologie qui tente d’appréhender par le même geste le danger et ce qui sauve. Toute technique est originairement et irréductiblement ambivalente : l’écriture alphabétique, par exemple, a pu et peut encore être aussi bien un instrument d’émancipation que d’aliénation. Si, pour prendre un autre exemple, le web peut être dit pharmacologique, c’est parce qu’il est à la fois un dispositif technologique associé permettant la participation et un système industriel dépossédant les internautes de leurs données pour les soumettre à un marketing omniprésent et individuellement tracé et ciblé par les technologies du user profiling. »
Définition du Pharmakon, Ars Industrialis.
Il s’agit avant tout de saisir le côté obscur du phénomène social décrit par Foucault et pour cela faire abstraction de son envers positif.
Les phénomènes que nous allons évoquer ne sont pas entièrement négatifs, il produisent des effets socialement et individuellement positifs mais ceux-ci sont généralement aperçus. Ce qui nous intéresse ici c’est d’extraire ce qui se trame en arrière fond pour en avoir conscience.
Discipline
Nous allons suivre le troisième chapitre de Surveiller et punir qui a pour titre Discipline. Je vous conseille de lire l'intégralité de l'ouvrage si vous en avez le courage mais ce n'est pas obligatoire.
Je ne vais proposer ni une explication, ni un commentaire linéaire mais une tentative pour rendre compte des idées principales du texte et de leurs liens avec notre monde actuel.
Leur demander de définir ce qu’est pour eux la discipline
Foucault élabore une définition singulière
La thèse qu’il développe est que nous vivons dans une société disciplinaire, c’est-à-dire que selon lui la discipline s’infiltre partout dans l’existence des individus et n’est pas isolée dans certains lieux singuliers. Nous nous efforcerons de voir comment et ce que cette modalité disciplinaire modifie dans nos existences.
Fondamental :
« Quoi d’étonnant si la prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux, qui tous ressemblent aux prisons ? »
p. 264