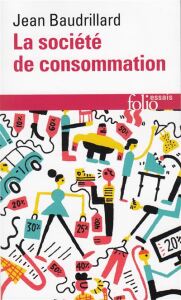Jean Baudrillard - La société de consommation
Le contenu
Nous sommes passés de l’industrialisation de la production à l’industrialisation de la consommation. Il convient dès lors de rendre compte des conséquences de ce nouveau modèle de civilisation. Que vivons-nous ? Quels processus déterminent aujourd’hui notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes ?
Baudrillard fait le constat d’un impensé qui nous structure. Il n’est pas ici question de désigner des responsables qui auraient minutieusement planifié une transformation sociale en vue de servir leurs propres intérêts. L’auteur fait plutôt le constat que notre rapport au monde induit par cette révolution reste inaperçu, il serait le résultat d’une intériorisation progressive par les individus, qu’ils soient riches ou pauvres ne change rien, ils restent victimes.
Que nous choisissions de servir le système ou de lutter contre lui, nous ignorons toujours ce qui le constitue essentiellement et finalement nous y participons. Comme s’il n’y avait plus d’extérieur, qu’il était devenu impossible de s’extraire de cette logique qui contamine tout. Ainsi, il ne convient pas d’attendre dans ces pages des solutions, nul échappée n’est ici envisagée. Il s’agit d’une description froide et désabusée de la déliquescence de nos sociétés ; une suite d’analyses et d’hypothèses qui tentent de définir la réalité qui nous environne et nous constitue.
Ce ne sont pas seulement les individus qui sont broyés par cette mécanique, les objets eux-mêmes perdent leur sens, leur matérialité. Nous ne sommes plus environnés que de signes qui se renvoient les uns aux autres et s’échangent sans arrêt ni sans but. Devenus incapables de trouver consistance à travers nos relations aux autres ou aux objets, nous sommes condamnés à consommer des signes qui visent à élaborer de toute pièce une personnalité qui s’essouffle dans l’apparence.
Cet ouvrage publié il y a plus de cinquante ans, au lendemain de mai 68, est d’une certaine manière prophétique puisque, de fait, nous ne nous sommes pas libérés, au contraire la logique s’est approfondie. Lire La société de consommation aujourd’hui nous amène à nous interroger sur le virage numérique qui a suivi, n’exprime-t-il pas la cristallisation de certaines hypothèses développées ici ?
De nombreux passages sont limpides mais certaines formules semblent inutilement complexes, on perd l’âme du texte pour sombrer dans une technicité abrupte. De même, des remarques et des digressions viennent s’enchâsser au sein d’une même phrase, ce qui rend la lecture pénible, le sens difficile à percevoir ici et là.
Reste des pages magnifiques et des idées fondamentales pour éclairer le monde dans lequel nous vivons.
Extrait
Dans la panoplie de la consommation, il est un objet plus beau, plus précieux, plus éclatant que tous — plus lourd de connotations encore que l'automobile qui pourtant les résume tous : c’est le corps. Sa « redécouverte », après une ère millénaire de puritanisme, sous le signe de la libération physique et sexuelle, sa toute-présence (et spécifiquement du corps féminin, il faudra voir pourquoi) dans la publicité, la mode, la culture de masse — le culte hygiénique, diététique, thérapeutique dont on l'entoure, l’obsession de jeunesse, d'élégance, de virilité/féminité, les soins, les régimes, les pratiques sacrificielles qui s’y rattachent, le Mythe du Plaisir qui l'enveloppe — tout témoigne aujourd’hui que le corps est devenu objet de salut. Il s’est littéralement substitué à l'âme dans cette fonction morale et idéologique.
Une propagande sans relâche nous rappelle, selon les termes du cantique, que nous n'avons qu’un corps et qu’il faut le sauver. Pendant des siècles, on s’est acharné à convaincre les gens qu’ils n’en avaient pas (ils n'en ont d’ailleurs jamais été vraiment convaincus). On s’obstine aujourd’hui systématiquement à les convaincre de leur corps. Il y a là quelque chose d’étrange. Le corps n'est-il pas l'évidence même ? Il semble que non : le statut du corps est un fait de culture. Or, dans quelque culture que ce soit, le mode d'organisation de la relation au corps reflète le mode d'organisation de la relation aux choses et celui des relations sociales. Dans une société capitaliste, le statut général de la propriété privée s'applique également au corps, à la pratique sociale et, à la représentation mentale qu'on en a. Dans l’ordre traditionnel, chez le paysan par exemple, pas d’investissement narcissique, pas de perception spectaculaire de son corps, mais une vision instrumentale/magique, induite par le procès de travail et le rapport à la nature.
Ce que nous voulons montrer, c’est que les structures actuelles de la production/consommation induisent chez le sujet une pratique double, liée à une représentation, désunie (mais profondément solidaire) de son propre corps : celle du corps comme CAPITAL, celle du corps comme FÉTICHE (ou objet de consommation). Dans les deux cas, il importe que le corps, loin d’être nié ou omis, soit délibérément investi (dans les deux sens : économique et psychique, du terme).
Notions au programme
Le bonheur L’inconscient Le langage La liberté La nature La religion Le temps Le travail La vérité