Mill - L'utilitarisme
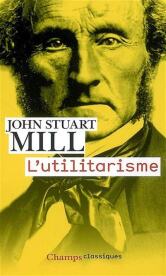
Première publication : 1871
Langue : anglaise
Écriture : exigeante
Silhouette : svelte
Coût : bon marché
Le contenu
À l'image de Kant dans les « Fondements de la métaphysique des mœurs » John Stuart Mill s'empare de la question morale.
Mais si, chez Kant, la règle de la moralité se découvre dans la solitude du sujet pensant, chez Mill elle surgit de l'interaction sociale.
Son objectif est clairement affiché : faire naître une nouvelle société nourrie aux mamelles de l' utilitarisme, fonder un ordre nouveau permettant au plus grand nombre d'accéder au bonheur, saper les fondements des croyances qui nous empêchent de construire un monde meilleur.
Il ne s'agit pas de construire une pure utopie mais de suivre un programme rationnel.
Premièrement, comprendre que l' utilitarisme ne vise, en définitive, que le bonheur du plus grand nombre.
Deuxièmement, nous convaincre de la pertinence de cette théorie. Pour se faire il ne cherchera pas à remonter à des principes métaphysiques fondateurs mais se contentera de démonter patiemment tous les autres systèmes afin de nous conduire à admettre que l' utilitarisme est la meilleure théorie au regard de la raison.
Troisièmement passer de la théorie à la pratique : à l'image des religions qui ont structuré en profondeur les mœurs des sociétés ou de la notion de progrès scientifique qui a progressivement renversé l'ordre religieux, John Stuart Mill souhaite utiliser l'éducation des masses pour que la force de l'habitude parvienne, au bout du compte, à modifier durablement nos idées morales et nos modes de vie.
Extrait
Dans une société coopérative de production, est-il juste ou non que le talent ou l'habileté donnent droit à une rémunération plus élevée ? Ceux qui répondent négativement à la question font valoir l'argument suivant : celui qui fait ce qu'il peut a le même mérite et ne doit pas, en toute justice, être placé dans une position d'infériorité s'il n'y a pas faute de sa part ; les aptitudes supérieures constituent déjà des avantages plus que suffisants, par l'admiration qu'elles excitent, par l'influence personnelle qu'elles procurent, par les sources intimes de satisfaction qu'elles réservent, sans qu'il faille y ajouter une part supérieure des biens de ce monde ; et la société est tenue, en toute justice, d'accorder une compensation aux moins favorisés, en raison de cette inégalité injustifiée d'avantages plutôt que de l'aggraver encore.A l'inverse, les autres disent : la société reçoit davantage du travailleur dont le rendement est supérieur ; ses services étant plus utiles, la société doit les rémunérer plus largement ; une part plus grande dans le produit du travail collectif est bel et bien son oeuvre ; la lui refuser quand il la réclame, c'est une sorte de brigandage. S'il doit seulement recevoir autant que les autres, on peut seulement exiger de lui, en toute justice, qu'il produise juste autant, et qu'il ne donne qu'une quantité moindre de son temps et de ses efforts, compte tenu de son rendement supérieur.Qui décidera entre ces appels à des principes de justices divergents ? La justice, dans le cas en question, présente deux faces entre lesquelles il est impossible d'établir l'harmonie, et les deux adversaires ont choisi les deux faces opposées ; ce qui préoccupe l'un, c'est de déterminer, en toute justice, ce que l'individu doit recevoir, ce qui préoccupe l'autre, c'est de déterminer, en toute justice, ce que la société doit donner. Chacun des deux, du point de vue où il s'est placé, est irréfutable et le choix entre ces points de vue, pour des raisons relevant de la justice, ne peut qu'être absolument arbitraire. C'est l'utilité sociale seule qui permet de décider entre l'un et l'autre.
Notions au programme
Le bonheur Le devoir L’État La justice La liberté La nature La raison La religion Le travail