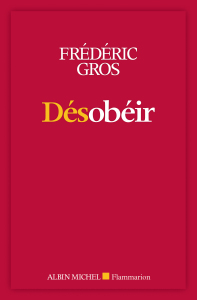Frédéric Gros - Désobéir
Le contenu
Ouvrage qui fourmille d'anecdotes historiques permettant d'illustrer la question de la légitimité de la désobéissance citoyenne.
Il a également le mérite de renvoyer à des lectures philosophiques diverses en présentant un grand nombre d'ouvrages.
Il s'agit moins de désobéir pour afficher son opposition mais de comprendre le concept de responsabilité, de « moi indélégable »
.
Ce monde va de travers, à tel point que lui désobéir devrait être une urgence.
Frédéric Gros réinterroge les racines de l'obéissance politique :
conformisme social,
soumission économique,
respect des autorités,
consentement républicain
C'est en repérant les styles d'obéissance qu'on se donne les moyens d'étudier, d'inventer, de provoquer de nouvelles formes de désobéissance.
Philosopher, c'est désobéir. Ce livre en appelle à la démocratie critique et à la résistance éthique.
Extrait
Une image, une légende plutôt: le drame de Claude Eatherly, dans la version au moins qu’en donne Günther Anders. Soit donc cette histoire qu'on aimerait croire vraie tant elle articule le drame de la responsabilité!. Claude Eatherly fait partie de la petite escadrille de pilotes d'exception sélectionnés par l’armée américaine pour procéder au bombardement nucléaire du Japon au mois d’août 1945. Dans ce cadre, il avait été désigné pour procéder au vol de reconnaissance météo qui devait servir à déterminer si les conditions d’ennuagement étaient favorables au largage des bombes au-dessus de Hiroshima. Il envoie bientôt son feu vert au pilote qui transporte la bombe atomique. Résultat : des dizaines et des dizaines de milliers de mort
À son retour, le héros de guerre est démobilisé, et présente bientôt des symptômes graves de dépression : il connaît des épisodes d’alcoolisme et d'addiction au jeu, accompagnés d'activités délinquantes (escroqueries, braquages). À chaque fois il est déclaré psychiatriquement irresponsable et séjourne en institution. C’est au début des années 1950 que naît dans la presse américaine la légende du héros repentant, devenu fou de culpabilité en prenant conscience du meurtre de masse dont il aurait été complice. Toutes ses conduites déviantes seraient l'expression d’une culpabilité sourde : Eatherly ne parvient pas à se trouver déresponsable des morts de Hiroshima, et il répond à ce cauchemar de culpabilité par des comportements pathologiques. Günther Anders, le premier mari de Hannah Arendt, philosophe de la catastrophe technique, prend connaissance de cette histoire. Bouleversé, il veut voir en Eatherly un martyr, le symbole d’une époque, une époque qui, dans son délire de la croissance technique, prépare la fin de l’humanité, une époque qui organise par la segmentation des activités l’aveuglement des consciences. La grandeur d'Eatherly, ce serait d'accepter de recevoir en pleine figure la violence de sa responsabilité, au point de devenir fou. Ou plutôt non : au point de manifester lucidement au grand jour sa culpabilité. Mais personne ne veut l'entendre (il est un héros de guerre !), parce que ce serait interroger la culpabilité de toute une civilisation. Et au moment même où il accepte de se reconnaître, lui, responsable, on le déclare fou et on l’enferme.
Günther Anders dessine donc cette silhouette du martyr de la responsabilité, et Eatherly endosse ce rôle et laisse circuler les légendes. Il laisse dire qu'il aurait pendant des années envoyé d'innombrables chèques aux associations humanitaires du Japon, en écrivant sorry au dos. Il laisse raconter qu'il aurait fait plusieurs tentatives de suicide après des nuits de cauchemar où il voyait les brûlés de Hiroshima se dresser en hurlant pour réclamer justice.
Eatherly aurait pourtant raisonnablement pu se dire : « Soyons sérieux, cette histoire ne tient pas, qu'est-ce que j'ai fait réellement ? J'ai constaté les conditions météorologiques et donné le feu vert au pilote qui portait la bombe. Et je vais, moi maintenant, me mettre sur le dos tous ces morts ! Mais enfin, si j'avais refusé d'effectuer ce vol, un autre à ma place serait parti immédiatement. »
Cela n'aurait fait aucune différence dans le réel Sauf que c'était moi. À part pour moi bien sûr, mais enfin rien m'aurait été transformé dans le monde et dans la tragédie. On aurait envoyé un autre pilote. Alors, la belle affaire. Sauf que c'était moi. Cette différence qui ne fait aucune différence, le pari de la morale et de la politique humaines, c'est d'affirmer qu'elle fait toute la différence : surgissement du moi indélégable. C’est ce moi qui désobéit.
Notions au programme
Le devoir L’État La justice La liberté