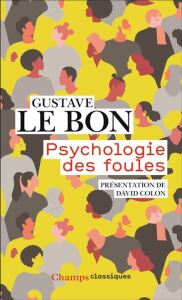Gustave Le Bon - La psychologie des foules
Le contenu
Si par philosophie nous entendons un certain usage de la rationalité et l’inscription dans une tradition alors cette Psychologie des foules n’est pas un ouvrage philosophique.
Le Bon ne s’encombre pas des outils traditionnels (distinction conceptuelle, postulat, argumentation progressive…), il se contente pour l’essentiel d’affirmer ses thèses en les accompagnant d’exemples. Grâce à la finesse de ses observations il parvient bien à toucher son lecteur, de fait, nous sommes emportés par certaines de ses assertions.
Son discours est sans aucun doute politiquement situé mais cela ne contamine pas l’ensemble, il nous étonne ici et là, nous le trouvons où nous ne l’attendons pas. Ainsi, il est difficile de sortir intégralement convaincu par son discours mais également difficile de le rejeter en bloc. Chacun y trouvera quelque chose à glaner et matière à critiquer.
L’auteur est convaincu que cette fin de XIXe siècle est sous la domination des foules, elles feraient la pluie et le beau temps.
Les gouvernants, les patrons seraient assujettis à ces masses sourdes à tout discours rationnel. Il convient alors de comprendre leur fonctionnement afin de les conduire efficacement. Le Bon propose donc une analyse des différentes formes de foule, leur manière de se constituer ou de se dissoudre et les facteurs qui les déterminent.
Au-delà de cette visée politique, le lecteur y trouvera également des éléments qui concerne l’individu. Qu’est-ce que le groupe fait à l’individu ? Quelles idées nous façonnent ? Quelles sont les limites du pouvoir de conviction de la rationalité ? Il y trouvera aussi une critique haute en couleur de certaines institutions.
Il est a noter que chez lui une foule n’est pas nécessairement nombreuse, nous ne sommes pas si loin du Pluriel de Brassens qui portait le nombre à quatre, Le Bon s’accorderait avec lui pour reconnaître que le groupe nous rend con, pourvu qu’on entende bien connerie comme bêtise sans lien nécessaire à la méchanceté.
Extrait
On constate aisément combien l'individu en foule diffère de l'individu isolé ; mais d'une pareille différence les causes sont moins faciles à découvrir.
Pour arriver à les entrevoir, il faut se rappeler d'abord cette observation de la psychologie moderne : que ce n'est pas seulement dans la vie, organique, mais encore dans le fonctionnement de l'intelligence que les phénomènes inconscients jouent un rôle prépondérant. La vie consciente de l'esprit ne représente qu'une très faible part auprès de sa vie inconsciente. L'analyste le plus subtil, l'observateur le plus pénétrant, n'arrive à découvrir qu'un bien petit nombre des mobiles inconscients qui le mènent. Nos actes conscients dérivent d'un substratum inconscient formé surtout d'influences héréditaires. Ce substratum renferme les innombrables résidus ancestraux qui constituent l'âme de la race. Derrière les causes avouées de nos actes, se trouvent des causes secrètes ignorées de nous. La plupart de nos actions journalières sont l'effet de mobiles cachés qui nous échappent.
C'est surtout par les éléments inconscients composant l'âme d'une race, que se ressemblent tous les individus de cette race. C'est par les éléments conscients, fruits de l'éducation mais surtout d'une hérédité exceptionnelle, qu'ils diffèrent. Les hommes les plus dissemblables par leur intelligence ont des instincts, des passions, des sentiments parfois identiques. Dans tout ce qui est matière de sentiment : religion, politique, morale, affections, antipathies, etc., les hommes les plus éminents ne dépassent que bien rarement le niveau des individus ordinaires. Entre un célèbre mathématicien et son bottier un abîme peut exister sous le rapport intellectuel, mais au point de vue du caractère et des croyances la différence est souvent nulle ou très faible.
Or, ces qualités générales du caractère, régies par l'inconscient et possédées à peu près au même degré par la plupart des individus normaux d'une race, sont précisément celles qui, chez les foules, se trouvent mises en commun. Dans l'âme collective, les aptitudes intellectuelles des hommes, et par conséquent leur individualité, s'effacent. L'hétérogène se noie dans l'homogène, et les qualités inconscientes dominent.
Cette mise en commun de qualités ordinaires nous explique pourquoi les foules ne sauraient accomplir d'actes exigeant une intelligence élevée. Les décisions d'intérêt général prises par une assemblée d'hommes distingués, mais de spécialités différentes, ne sont pas sensiblement supérieures aux décisions que prendrait une réunion d'imbéciles. Ils peuvent seulement associer en effet ces qualités médiocres que tout le monde possède. Les foules accumulent non l'intelligence mais la médiocrité.
Notions au programme
Le bonheur La conscience L’État L’inconscient La liberté La raison La religion La vérité